Archéologie et Ville…
…chez Michel Butor et Henri Maccheroni
C’est Raymond Jean, un écrivain que j’avais
rencontré à Aix en 89 qui m’a guidée vers Henri Maccheroni…

Béatrice Bonhomme
écrivaine, poète, essayiste et directrice de Revue française.
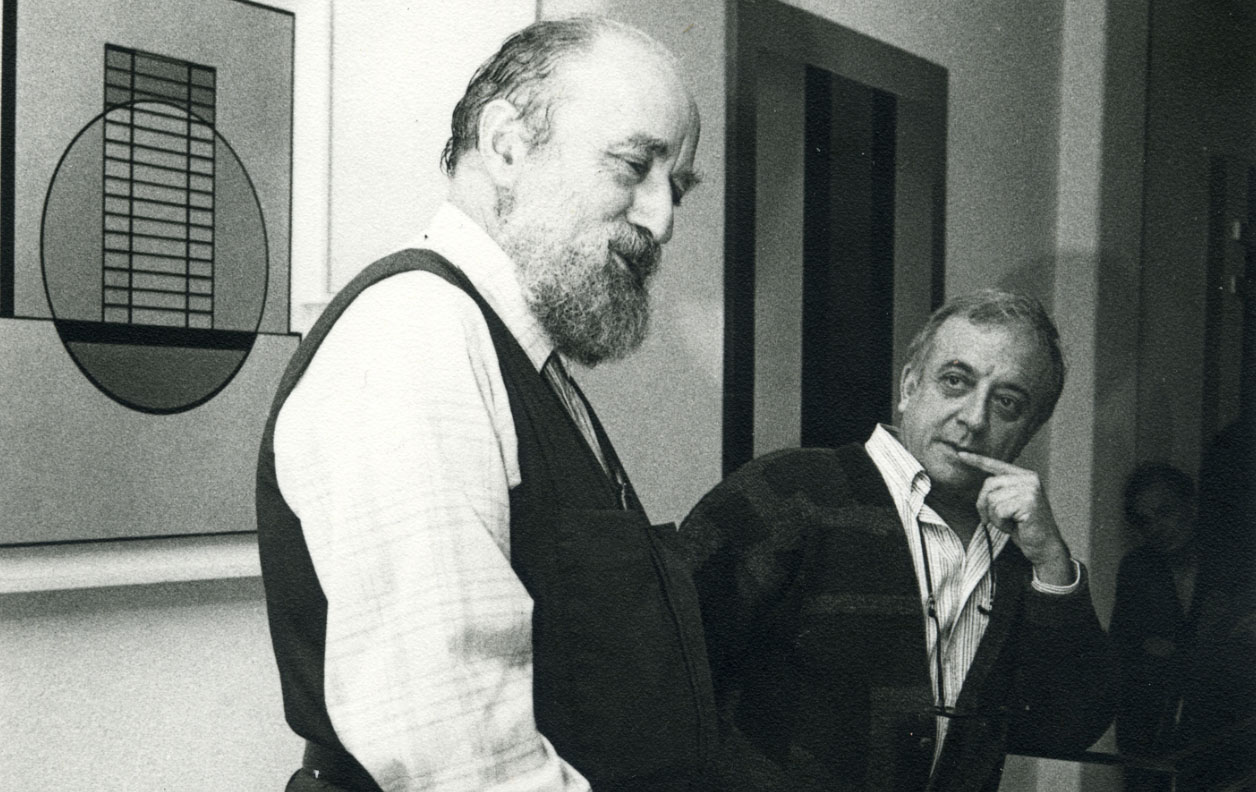
Michel Butor et Henri Maccheroni
Je dirai d’abord en quelques mots comment j’ai connu l’oeuvre d’Henri Maccheroni, au moment où j’ai créé la revue NU(e), en 1994. C’est Raymond Jean, un écrivain que j’avais rencontré à Aix en 89 qui m’a guidée vers Henri Maccheroni. Les deux premiers numéros de la revue étaient déjà parus lorsque je suis allée voir Henri Maccheroni chez lui à Nice.

Parmi les très nombreux peintres avec lesquels l’écrivain a collaboré, Henri Maccheroni est sans doute un de ceux qui comptent le plus pour Michel Butor, peintre avec lequel il a bâti une véritable œuvre croisée.
Avec Henri Maccheroni, nous avons accompli plusieurs oeuvres croisées puisque tout d’abord il a fait deux gravures pour mon livre de poèmes Les Gestes de la neige paru chez l’Amourier en 1998. Ensuite, j’ai écrit L’Embellie pour une suite de photos du sexe d’une femme. Le livre manuscrit est accompagné de photos qui forment comme des sortes de paysages. En outre, j’ai publié dans mes éditions un livre d’artiste Lumière d’arbre avec un texte de Dominique Cerbelaud et des lavis de Henri Maccheroni. Puis nous avons sorti deux revues, l’une avec les textes de Jean-Claude Renard, l’autre avec les textes de Claude Louis-Combet. Nous avons participé ensemble au retour de Michel Butor à la Faculté des Lettres de Nice en 1998, rencontre qui a pu donner lieu à des lectures, à une exposition (12 octobre-15 novembre 1998), et à la publication en partenariat avec NU(e) d’une photo d’Henri Maccheroni : « Tombes titubantes » avec un texte de Michel Butor : « De la ville et de quelques autres lieux ». Cette rencontre a été poursuivie par Maria Cristina Pirvu, qui, en 2010 a proposé un parcours sur Michel Butor au sein de la Bibliothèque Universitaire avant la publication de sa thèse en 2011 chez l’Harmattan : Le retour en avant, Michel Butor et le problème poïétique de la répétition. Ce travail présent n’est pas entièrement original, puisqu’il constitue une reprise d’un certain nombre de mes articles déjà écrits sur ce même thème [1], enrichis cependant largement ici par un entretien (22 décembre 2014) avec le peintre et par un certain nombre de réflexions nouvelles.
On sait combien le rêve d’une sorte de totalité scripturale-picturale hante le travail de Michel Butor. On connaît l’impressionnante quantité de livres d’artistes qu’il continue à faire jour après jour dans une exigence de totalité alchimique, dans un rêve de création et de savoir absolus. Parmi les très nombreux peintres avec lesquels l’écrivain a collaboré, Henri Maccheroni est sans doute un de ceux qui comptent le plus pour Michel Butor, peintre avec lequel il a bâti une véritable œuvre croisée. Henri Maccheroni a toujours tenu à placer « l’écrit au centre de son dispositif » et dans ses collaborations avec Michel Butor et il a refusé « le terme d’illustrateur qu’il considère comme réducteur ». Son intervention dans les livres de Butor consiste à accompagner l’œuvre écrite « par d’autres moyens ». « Il s’agit, en fait, de créer une véritable équivalence physique au texte littéraire de sorte que les deux univers s’interpénètrent en une heureuse rencontre » qui est œuvre croisée (Tessa Tristan, 18) [2]. Nous suivrons donc le cheminement complice de ces deux créateurs à travers leur grand thème fondateur de l’archéologie et de la ville dans l’entrelacement des formes de création scripturale et picturale. Je me référerai, tout au long de ma communication, à un entretien que j’ai eu dernièrement avec le peintre à son domicile niçois (lundi 22 décembre 2014). Notons, c’est essentiel, que c’est Butor qui va le premier s’intéresser au travail de Maccheroni et chercher à rencontrer le peintre, justement parce que sa façon de traiter de la ville a retenu son attention dans la mesure où il y retrouvait quelque chose de sa propre démarche. Pour Maccheroni, le premier choc de la ville, c’est d’abord Nice, sa propre ville. C’est la première imprégnation, puis – cela étant sans doute lié à cette ville natale, qui comporte des sites archéologiques – il a commencé à s’intéresser à d’autres villes à fort passé archéologique. Tout d’abord le peintre se tourne vers Athènes, où il se baigne sous le temple de Jupiter, puis Istanbul. Il y a toujours un va-et-vient fécond entre la présence archéologique et la période plus vivante de villes actuelles qui continuent à vivre : « Quand nous flânons parmi les ruines / d’Herculanum ou Pompéi / nous essayons de repeupler / cette carapace vidée / de toute vie quotidienne / nous rebâtissons les plafonds / absents ou parfois remplacés / par de simples abris de tôle [3] ». C’est ce lien, cette tension entre permanence archéologique et vie d’une ville au présent qui intéresse Maccheroni. « Nos villes sont les futures ruines de nos descendants, nous serons et nous sommes déjà, une archéologie [4] ». Et, curieusement, la visée archéologique, Butor la voit comme une façon de ré-habiter des sites abandonnés, des villes mortes et d’y réintroduire de la vie. L’archéologie est une reconstitution : « Il nous faut tout reconstituer / à partir de fragments de textes / de peintures ou céramiques / en nous plongeant dans un abîme / de possibles tourbillonnants / où tout s’agite sans savoir / qu’un volcan va se réveiller / pour tout recouvrir d’amnésie [5] ». Cette idée archéologique a donné naissance à des séries comme, par exemple, Archéologies blanches. Puis, quand la photographie entre à part égale comme matériau avec la peinture, par tressage et composition de matériaux, Maccheroni se met à photographier des sites, par exemple les sites pharaoniques en compagnie justement de Michel Butor qu’il surnomme alors «Flaubert», tandis que ce dernier le nomme « Decamps », ce qui souligne la profondeur de leur complicité amicale et créative (Entretien du 22 décembre 2014). Puis ce sont les grands sites tunisiens, les abbayes normandes en ruines. Dans le domaine archéologique, tous les sites photographiés jusqu’à très dernièrement étaient uniquement minéraux. Mais, avec Tipasa, une autre composante entre en ligne de compte car Tipasa, d’après les termes mêmes du peintre, est un site « archéo-floral » où le minéral existe mais comme enfoui dans la nature. S’entremêlent ainsi un site non contemporain archéologique et un site naturel de notre temps, dans notre présent de vie, mais qui s’ancre aussi plus largement dans tous les temps par sa nature végétale.
L’Archéologie
La ville, constituant un voyage dans l’ancien et le nouveau monde, comprend en effet en elle la thématique de l’archéologie. Le temps de la ville relie les temps référentiel, légendaire, mythique et archéologique. Butor montre, lui aussi, que la modernité est impossible, s’il n’existe pas le soubassement de la mémoire et la quête de l’origine. L’archéologie consiste en cette quête de retrouvailles avec le passé. Sans le passé et sa reviviscence, tout risque de se vider, de perdre sa consistance : « Notre environnement se vide / en silence révélateur / où êtes vous où sommes-nous / venez rapprochez-vous un peu / nous avons tant besoin de vous / retrouvez votre consistance / mais où donc étiez-vous passés ?[6] » Les références à l’antiquité servent ainsi de repères à l’évocation de la cité. Il y a présence quasi obsédante et complémentaire du nouveau et de l’ancien monde, l’antiquité intervenant comme une tentation, une résurgence qui fait de toute ville un lieu hanté par ses origines. Les rapports entre antiquité et modernité semblent tout d’abord davantage de l’ordre de la rupture que de la continuité, lutte entre le vieux et le nouveau monde. Mais devant un passé, dont les traces ne se laissent effacer ni sur le destin individuel ni sur le destin collectif, il faut adopter une autre stratégie que le rejet, et celle-ci relèvera de l’ordre de la création, de la tension créative. Il y a fissure, mais aussi possibilité, dans une sorte d’entrelacement du temps, de récupérer le passé dans le présent et de cesser de percevoir ces deux pôles comme fragmentaires et contradictoires. Le voyage dans la ville constitue le gage de cette réconciliation qui permet de relier les écarts spatiaux et temporels, voyage qui s’opère pour Maccheroni à travers la photographie. Par le monument photographié on échappe au grand travail de l’oubli. Henri Maccheroni, par l’intermédiaire de la photographie, fait lien, collabore avec le passé, lui sert de relais. Le monument, forme-sens, est un être de mémoire. Passage entre le temps immémorial dont témoigne le monument et le temps de la photographie qui l’énonce au présent. « Une geste » exemplaire. Une pensée de l’originel. Mircea Eliade ne définit pas autrement le temps du mythe, celui où s’accomplissent les modèles auxquels l’homme archaïque indéfiniment se réfère ou qu’il revit, reconstruit. L’antiquité, retour à la nostalgie, représente ce premier pas vers la guérison qui signifie que ce n’est pas en niant ses propres fantômes que l’on pourra s’inventer une individualité nouvelle. C’est au contraire après avoir reconnu et assumé la totalité de ce qui nous constitue que nous parviendrons à tout réunir, transgresser et subvertir. Déchiffrer une ville, c’est en faire une lecture à la fois synchronique et diachronique. Il s’agit de déchiffrer tous les signes qui s’organisent en elle, en chercher l’origine pour en reconstituer l’histoire[7]. Les monuments résultent ainsi de plusieurs stratifications historiques. Ils permettent une plongée de plus en plus profonde vers les origines et le peintre est comme un archéologue ou un géologue qui, dans ses fouilles, rencontre les terrains les plus récents puis, de proche en proche, gagne les plus anciens. La quête est celle d’un temps originel, celui collectif de l’Histoire et du Mythe, le peintre cherchant à faire resurgir le refoulé imaginaire. Les monuments sont comme des blessures, des cicatrices à déchiffrer, les vestiges de mythes fondateurs. Il ne s’agit pas seulement de voir mais aussi d’apprendre à lire. De fait, c’est cette métaphore du déchiffrement qui revient chez Butor dans l’évocation du mystère de la ville. Il existe un déchiffrement de la ville, livre, photographie et image tout à la fois. La ville accumule, au cours des siècles, des strates alluvionnaires et l’activité de l’écrivain et du peintre se situe entre amoncellement, stratification et, tout à la fois, érosion, la blancheur de la feuille étant comparable à une épaisse couche de peinture que la plume ou la pointe du couteau grattent : « La blancheur de cette feuille, c’est une épaisse couche de peinture : ce qu’elle recouvre c’est un miroir, cette épaisse couche de peinture que ma plume gratte telle une pointe de couteau, telle une flamme de chalumeau pour me révéler peu à peu, au travers de toutes ces craquelures que sont mes phrases, mon propre visage et le tien derrière lui, Bleston, le tien miné de guerre intime. » (L’Emploi du temps). L’écriture comme la peinture apparaissent, de façon contrastée, d’une part comme sédimentation, fossilisation, laissant s’accumuler les pages et les séries de tableaux, et d’autre part grattage, palimpseste, écriture et peinture comme extraction, fouille qui font remonter à la surface les événements qui dormaient à la profondeur. Maccheroni déclare : « Le temps est pour moi une chose très importante, le temps physique, l’idée de temps, j’effectue une poursuite du temps à travers tout ce travail archéologique» (Entretien du 22 décembre 2014). La ville est ainsi stratifiée, ville palimpseste, parchemin dont on a effacé le premier texte pour en écrire un nouveau, puis effacé le second pour en écrire un troisième. Le livre et plus particulièrement le livre d’artiste qui en est la forme privilégiée, par sa structure, sa forme matérielle de feuilles entassées, volumen, est pareil à l’architecture de la ville ou de la toile, pages empilées, rayées de lignes d’écriture et de traits, amoncellement de phrases et d’images semblables aux ruines d’une ville inachevée.
Comme pour Butor, l’archéologie constitue pour Maccheroni une notion fondamentale et c’est encore sur cette notion que les deux créateurs vont se rencontrer. «L’art indissolublement se mêle de mémoire […] La poétique des ruines, celle des mondes disparus, tous les mythes des origines [9] », le site archéologique maintenant en suspens « les vestiges de la puissance et de la gloire comme autant de symboles épars des civilisations passées » (Tessa Tristan, p. 23). « Ce que l’archéologie nous dévoile est ce qui était enfoui, que la poussière du temps avait recouvert [10] ». L’Archéologue, toile peinte en 1974 inaugure, de manière archétypale, les Archéologies et toutes les variations qui vont s’ensuivre. « Elle s’inspire très concrètement d’un panorama de rochers érodés par le gel près de Saint-Barnabé, canyon inattendu dans les Alpes maritimes, panorama très aimé de Butor et rebaptisé par l’écrivain : Le Parlement des idoles. Ce site a engendré, chez Maccheroni, l’idée de la série des Paysages archéologiques […] qui précède les Archéologies blanches » (Tessa Tristan, p. 24) : « Sur du papier fait main s’inscrivent des éléments-fragments archéologiques, décalés, superposés. Aquarelles rouge antique cernées de noir, buvardées. La déchirure partage feuilles et formes […], accentuant la fragmentation des signes lisibles ou devinés […] [11]. »
Le thème archéologique va ensuite se prêter à l’exploration de la mort. La série photographique des Sites égyptiens (1987) nous fait découvrir d’autres éléments d’architecture, tombes, temples ou palais revisités par l’ombre et la lumière, chargés d’énigmes. « L’objet-fossile, c’est d’abord le squelette, car ce qu’on trouve dans les fouilles archéologiques ce sont les ossements, les pièces de squelette, le crâne » [12]. Il est facile de montrer la prégnance de cette thématique en relevant quelques-uns des termes utilisés par Butor pour décrire l’œuvre de Maccheroni : « coffre-fort, couvercle qui va s’ouvrir, races englouties, villes abolies, creuset, ossements, talisman, secret, fermentation enfouie, ensevelissement, momie, pyramides ; sarcophages embaumés, bandelettes, papyrus, linceuls, ventre des âges, fantômes de siècles, prophéties, visions, litanies, sur la nappe du temps qui tourne les espèces réconciliées préparent la fin de notre initiation [13] ».
Cette superposition de couches, ou ce ruissellement des couches l’une sur l’autre, invite le spectateur à fouiller indéfiniment. Le verre [21], dans la série des Bocaux, introduit ainsi, avec sa transparence, un élément essentiel. Cette matière subtile permet la traversée du regard et l’emblématise. Il induit une variété de transparence et de profondeur pouvant être considérée comme une « mise en abyme » infinie. Ainsi Maccheroni joue-t-il beaucoup sur les notions de transparence, de porosité, de passage, de pénétration ainsi en est-il des images de la ville qui apparaissent circonscrites à l’intérieur d’un crâne, ce dernier jouant alors le rôle de bocal archéologique, bocal de la condition humaine, de sa vanité et de sa précarité. Pensons particulièrement à Tocsin avec ses images de tours détruites par les attentats du 11 septembre qui apparaissent à l’ intérieur d’ un crâne. L ’ espace se démultiplie et se feuillette perpétuellement par des superpositions ou des techniques de fissuration. Maccheroni arrive à créer un véritable espace architectural par cette stratification des matières. «L’espace stratifié » avait d’ailleurs été « souvent utilisé dans le passé à cause de ses immenses vertus décoratives et il se liait de manière adéquate à l’architecture, à la fresque antique ou à la mosaïque byzantine. Sa souplesse faisait que la surface sur laquelle l’image se déployait n’était pas niée mais en quelque sorte glorifiée [22] ». Ainsi l’espace stratifié fait-il partie d’une tradition en même temps qu’il est résolument moderniste et il associe antiquité et modernité, héritage revisité. Chez Butor, comme chez Maccheroni, l’exploration se fait vers des strates de profondeur de façon à révéler la vérité recélée et engloutie : « je cherchais dans ces panneaux les lumières de ton origine, Bleston » (L’Emploi du temps). Les fondations, les recherches de vestiges originels, les fouilles ou détections archéologiques, permettent de remonter le temps jusqu’à une origine destinée à fournir l’explication des faits présents. La ville est hantée par ses origines. Ainsi Michel Serres peut-il déclarer à Butor : « [L]e trou que vous cherchiez, le vide que vous redoutiez, c’est le point où gît le trésor, la matrice de l’écriture [23] ». La dimension de l’originaire fonde donc les œuvres de Butor et de Maccheroni, ce point évoquant aussi bien l’avenir qu’un retour vers l’origine. Le créateur, écrivain ou peintre, est un alchimiste, un archéologue mental. S’il faut creuser, fouiller, remonter les strates, c’est pour accéder à un état de conscience supérieur. L’alchimie est une recherche, une enquête et une quête, la recherche de quelque chose de perdu. Il s’agit de décrypter les valeurs symboliques dans un effort herméneutique, dans un labeur d’éclaircissement et de fouille. Pour Butor, comme pour Maccheroni, il existe un parallèle entre l’alchimiste médiéval et le créateur moderne : « [J]e vous vois maintenant, rues de Bleston, vos murs, vos inscriptions et vos visages; je vois briller pour moi, au fond de vos regards apparemment vides, la précieuse matière première avec laquelle je puis faire de l’or ; mais quelle plongée pour l’atteindre et quel effort pour la fixer, la rassembler, cette poussière » (L’Emploi du temps).
Le labeur de l’alchimiste – qui, dans l’athanor, essayait de transmuer les métaux vils en or, opus alchimicum apportant le sens du spirituel et du sacré – ressemble beaucoup à celui de l’écrivain et à celui du peintre [24].
La Ville contemporaine
Insensiblement Maccheroni passe de l’archéologie au rapport à la ville contemporaine New-York en 1979, Manhattan (1982), ville dressée, ville droite, verticale. « Le thème de la ville […] revient de manière constante et sous des formes variées […]. Pour lui, la ville est un lieu de concentration des signes et des activités humaines ». Outre « l’agitation frénétique, la vitesse et la complexité de la ville contemporaine[25] », l’aspect vertical le retient : « Depuis les premières Archéologies blanches et leurs plans de cités archéologiques, la ville sous-tend un ensemble de séries aux titres génériques: New York first time, Stèles pour une ville, Manhattan gris, Paris ville ténèbres, les Emblèmes de la ville “où verticales et horizontales / des rangées de lignes glissent / de trames en damiers / leurs faisceaux hésitants” [26]. » De Manhattan, il passe à Jérusalem (1996), Venise, Florence (2000). Il aime parcourir ces villes la nuit comme Paris, ville-ténèbres (2000), par exemple. Le livre intitulé Tocsin avec Michel Butor s’appuie, cette fois, comme je l’ai dit, sur les événements du 11 septembre, et donne à voir un module répétitif de crâne dans lequel s’inscrit la découpe de photographies de l’événement tragique. On se souvient de l’importance du motif du crâne dans la série des photographies du sexe d’une femme. On retrouve ici le topos des Vanités. Ville-vanité. Ville- palimpseste. Ville-mémoire. La ville, « univers de toutes les pluies », contient tout notre espace-temps. La ville est marquée par le temps, sa modernité puis, de façon complémentaire, sa destinée, sa destruction, sa finitude, sa précarité, pour retrouver, au bout du compte, de façon cyclique, comme un autre pan de sa modernité, une phase archéologique et cela s’incarne à travers les matériaux de la photographie comme de la peinture : « Peinture et photographie n’y ont plus pour objet la copie du réel mais la transposition picturale d’une idée. [Maccheroni] va ainsi osciller de la photographie des lieux (New York), à la réintroduction de la peinture dans la photographie (Les Manhattan gris) » (Tessa Tristan, 11). La cité est comme figée dans le temps, elle croit même être figée éternellement mais elle ne l’est pas, elle est susceptible d’être détruite, mais sa précarité, sa fragilité même est remise dans le courant du temps, remise à flot par la création : « Travaux photographiques sur la ville et ses architectures, la villa archéologique et la cité moderne, liées sémantiquement dans “un imaginaire élargi de la ville” » (Tessa Tristan, 111)[27]. La ville apparaît aussi à Maccheroni et à Butor comme une sorte de livre, texte rempli d’icônes, de panneaux, d’inscriptions, de publicités entraînant une lecture différente : « La fonction de la ville comme accumulateur de texte est tellement importante que l’on peut se demander si ce n’est pas là sa racine principale […] [28] ». Par « texte de la ville », Michel Butor entend l’immense masse d’inscriptions qui la recouvre, les mots qui attendent, qui assaillent partout. Cela disparaît en partie la nuit, la ville acquérant alors un autre statut, et devenant complètement différente, porteuse d’énigmes et de labyrinthes, même si « Les nuits de Maccheroni sont des nuits trouées de lumière [29] ».
Par ailleurs, la ville inspire des séries [30] . Ville-partition, musique sérielle, architectures des grandes orgues. On sera frappé comme certaines lignes architecturales des séries sur New-York évoquent cet instrument de musique. Chaque série est constituée d’un ensemble d’ingrédients picturaux ou autres qui sont identiques pour chaque pièce mais chaque pièce est différente de celle qui la précède et de celle qui la suit. Répétition et variation, rythme, le moteur de la création étant constitué par le désir, la quête, car dans les séries c’est toujours comme s’il y avait une « pièce manquante » qui permettait de mettre en mouvement le processus de création. Comme le dit le peintre, la ville est un puzzle, une énigme. Tout se qui se passe derrière les murs, les façades de la ville, on ne le voit pas, à moins de catastrophe, de guerre ou de tremblement de terre : « Ainsi quand nous rentrons chez nous / les murs deviennent transparents / volcans germent à l’horizon / avec leurs nuages de menace / nous ôtons leur couvercle aux chambres / souvent empilées par dizaines / chaque objet nous devient précieux / comme rescapé d’un désastre [31] ». C’est dans cette énigme de la vie qui nous est toujours cachée que réside la beauté de la ville, son mouvement. Si on trouve la pièce manquante qui constitue une sorte d’absolu inatteignable, de métaphysique intouchable, de quête du Graal, il faut s’arrêter. Et alors naîtra une nouvelle série qui remettra en branle le processus de création, le geste du peintre (Entretien du 22 décembre 2014). Or ce geste de séries est proche de celui de l’écrivain, Michel Butor travaillant également par séries, cinq Matières de rêve, cinq Répertoires…
La ville, c’est aussi retraverser un héritage. Retrafiquer, réinterpréter: «L’entrecroisement des références, des codes et des signes va s’intensifiant. La série Manhattan gris intègre et agence simultanément le travail de la bande entrecroisée et la photographie en contre-plongée » (Entretien du 22 décembre 2014). Dans des découpes verticales régulières s’entrelace une photographie de Manhattan. L’entaille est métaphore visuelle de la violence urbaine, mais la traversée, le passage, la porosité des matières fait lien à travers l’entaille elle-même. Comme l’explique Maccheroni : « Je fais d’abord une peinture de plans juxtaposés, superposés un peu comme dans l’art concret. Je choisis une photo et j’entaille. La photo s’introduit dans les ouvertures qui sont faites à intervalles réguliers d’un centimètre » (Entretien du 22 décembre 2014). Du travail de tressage ou de tricotage, donc. Du travail textuel. Détourner ce premier plan, cette matière, c’est créer de la pensée. Et les différentes séries aussi sont tressées entre elles et s’interpénètrent. Maccheroni insiste alors, de façon liée, sur l’importance du livre. Il travaille sur les livres, le livre est une architecture. Il fixe une série. La plupart des livres reprennent une série, la publient et ainsi permettent un achèvement de la série (Entretien du 22 décembre 2014).
De la même façon, la ville, chez Butor, est avant tout liée à l’écriture et à la création. « Les recherches archéologiques nous apprennent que, partout sur la planète, les premières grandes villes sont contemporaines de l’invention de l’écriture au sens propre du terme, quel que soit le mode de celle-ci [32] ». Pour l’auteur, la description d’une configuration urbaine est inséparable d’un architexte qui se constitue à partir d’une ville-prétexte. Le livre en train de s’écrire s’édifie comme une ville tandis que la ville apparaît comme un immense texte à déchiffrer. Déchiffrer une ville, c’est chercher à faire apparaître le génie de ce lieu et pour cela réussir à s’introduire dans des sortes de failles, de fissures, passer sous la surface, comme le fait matériellement, concrètement Maccheroni quand il tricote (une maille à l’endroit, une maille à l’envers) la photo avec le support peint et qu’il fait traverser la photo à travers les entailles régulières. Lire une ville pour Butor, c’est une voix à écouter, un discours à déchiffrer, un enseignement à recueillir. La première étape du déchiffrement est celle du regard, porter un regard sur la ville, visiter, visionner des « travelogues » ou documentaires consacrés aux cités, scruter le ciel, multiplier les points de vue, contempler les vitraux d’une cathédrale, revoir et vérifier le moindre recoin des plans. Il y a déjà ici l’œil photographique, l’œil du peintre. La ville répond donc, comme cela le serait pour un peintre ou un photographe, à une visualisation et donne lieu à des visions. De même que le regard du lecteur synthétise les éléments constitutifs d’une phrase, d’un texte, de même lire une ville consiste à en avoir une vue d’ensemble, à en percevoir la structure. Dans le labyrinthe d’une ville- Minotaure, le cordon de phrases est comme un fil d’Ariane, lignes de mots ou linea corda, corde de lin bien nécessaire pour sortir du labyrinthe mais lignes aussi comme combat, rempart de lignes, luttant contre l’aliénation menaçante : « j’ai décidé d’élever autour de moi ce rempart de lignes sur des feuilles blanches » écrit ainsi Butor dans L’Emploi du temps.
De même que chez Butor, la ville, chez Maccheroni, sous-tend un ensemble d’œuvres aux titres génériques. Ce thème ainsi que celui de la ligne, très lié à Butor, revient de manière itérative sous des prismes extrêmement divers dans l’étendue de son œuvre picturale : « […] des bandes de papier adhésif de formats différents s’inscrivent dans du carton beige destiné à la protection des plaques métalliques. […] [L]es bandes se croisent, se superposent, convergent ou se brisent pour former des lignes, signes, lettres ou écritures [33]. » La dimension de nervurage ou de hachurage, c’est-à-dire de ligne verticales serrées comme un rideau engendrée par la thématique de la ville de New York ou des grandes métropoles, fait intervenir des lignes droites en séries et en même temps des recoupements labyrinthiques aventureux. Sous l’aspect mécaniste de la structure des villes et sous la raideur des nervures, une désorganisation reste tout de même sensible dans les rencontres et les recoupements de lignes, conférant au spectateur du tableau une impression de vitesse. Dans Manhattan-gris l’intervention de la photographie intercale entre les lignes graphiques des photos de gratte- ciel. On découvre alors quelque chose de théâtral, comme une sorte de lever de rideau, dans ces perspectives qui s’ouvrent et se referment comme des éventails. La mise en mouvement se produit grâce à un effet de double fond tramé entre nervures, caches et photos. On pense à la technique scripturale de Butor mise en place dans L’Emploi du temps où les lieux et les temps ont respectivement tendance à se télescoper, à se superposer et à se contracter : « [C]ette place de la Nouvelle Cathédrale couverte d’affiches anciennes recouvertes par d’autres […], plusieurs épaisseurs d’affiches dont j’apercevais des fragments à plusieurs niveaux au travers des déchirures de ces dernières. » (L’Emploi du temps). On pensera également à la série Défense d’afficher de Maccheroni qui reprend la « matériologie du mur […] en y incorporant certains de ses signes pensés comme des tags » (Tessa Tristan, 116).
Déambuler dans une ville, c’est, pour les deux créateurs, parcourir le tissu urbain mais aussi rencontrer quelque vestige qui fonde notre culture et nos mythes. Chez Butor, comme chez Maccheroni, une métaphore commune rapproche la ville, le texte et la toile : celle du tissu. De fil en aiguille, la métaphore textile nous amène ainsi à parcourir l’espace urbain pour y découvrir ses divers aspects et à les coudre, les suturer : ville-tissu, ville réseau, filet, rets, écheveau. La ville, ce n’est pas une voie mais un réseau, l’espace urbain n’est pas linéaire mais circulaire, donc propice à la circulation, et le livre est également une superposition de lignes puis de pages, un volumen, un volume, enroulement ou rouleau. Dès lors, la ville comme superposition de strates comporte une structure architecturale, le livre ou la toile constituant une transformation moderne de l’architecture, une architecture devenue pleinement mobile, libérée de son lieu. L’idée surgit d’une création, littéraire ou picturale, qui serait à la fois architecture et livre des sites, des monuments, dans lesquels le langage apparaîtrait sous tous ses aspects [35]. Car l’essentiel chez Maccheroni est également la présence du tissage. Il n’est que de lire les nombreuses métaphores empruntées à la couture qu’utilise Butor lorsqu’il écrit sur l’œuvre de Maccheroni : « [U]n repli du tissu […], le matelas se replie[…], je m’attaque à la couture avec les dents […], couverture dont je me recouvre la tête et qui me fait une cape […]. Une grande lézarde se dessine avec des plaques de plâtre qui se soulèvent pour découvrir les briques et le drap se déchire [36] ». Le sentiment de l’espace change dans la mesure où il y a tissage, tressage et où cela produit un espace comme « feuilleté ». « Dans Egypte-Bleu, on trouve du tissage et du tressage comme développement du thème de la toile [37] ». La bande chirurgicale devient « bandelettes », c’est-à-dire ce qui entoure la momie à l’ intérieur des sarcophages égyptiens. Des pyramides, venues d’ un temps immémorial, contrastent avec l’époque contemporaine. « Manhattan-Gris évoque, quant à lui, la thématique de la ville comme vêtement [38] ». Ce moment où la ville fascine particulièrement Maccheroni est celui où les immeubles sont rayés comme des costumes de bagnards. Le peintre s’attache à ces gratte-ciel comme rayures mais aussi comme broderies avec le thème des Gothiques. L’intercalage, le damier, le tissu, le tressage, sont donc essentiels et déploient bientôt le thème du carrefour, du dispatching, faisant référence à l’idée du clavier [39] et des orgues. L’œuvre croisée Butor-Maccheroni est symbolique de cette rencontre essentielle entre écriture et peinture.
Le rêve de l’écrivain et du peintre, dans leurs livres d’artistes, est d’étaler et de visualiser l’espace, en constituant des livres à facettes qui respectent les propriétés visuelles de la graphie, de la mise en page, de l’écriture et de la peinture. La simultanéité soustrait le lecteur au temps univoque d’une lecture linéaire, le texte pouvant se lire en étoile, c’est-à-dire dans toutes les directions. « Comme s’il se trouvait dans une cathédrale, dans une ville [ou dans un tableau], il est permis au lecteur [-spectateur] de se promener à ses risques et périls à l’intérieur de l’édifice romanesque ou de l’édifice pictural, d’inventer des trajets et de porter l’entière responsabilité des parcours qu’il a programmés de sa propre initiative [40] », déploiement simultané du livre et du tableau. Ainsi la narration apparaît-elle comme une surface double, une image appelant un texte et un texte une image.
Butor et Maccheroni rêvent « d’abattre le mur fondamentalement édifié entre les lettres et les arts, c’est-à-dire de réconcilier peinture et littérature en une œuvre totale, où parole et image se trouveraient confondues dans l’indistinction de la vérité [41] » qui est à la fois quête de l’origine et recherche de modernité et, dans ce cheminement, la ville comme image fondamentale de modernité et d’archéologie tout à la fois, comme un beau corps transporte en lui son squelette, reste une image qui déclenche la créativité du peintre comme de l’écrivain [42].
1. Béatrice Bonhomme, « La véritable recherche, Etude littéraire du chapitre IV de la première partie », Analyses et Réflexions sur Michel Butor, L’Emploi du temps, La ville, Paris, Ellipses, 1995, p. 119-122. Béatrice Bonhomme, « Antiquité et modernité dans La Modification de Michel Butor », Antiquités et Nouveaux mondes, Tome 1, dir. Josiane Rieu, Université de Nice Sophia Antipolis, Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de Nice, Nouvelle série N° 35, CRLP, 1996, p. 273-290.
Béatrice Bonhomme, « Le Nouveau Roman, à partir des années 1950 », Le Roman au XXe siècle à travers 10 auteurs, Paris, Ellipses, 1996, p. 158-178.
Béatrice Bonhomme, « Ville et archéologie chez Butor », Michel Butor à Nice, exposition 11 mars-7 mai 2004, Bibliothèque Nucéra, Mélanges publiés à l’occasion de l’exposition, coordination scientifique Laurence Jeandidier, patrimoine écrit de Nice, tome 6, p. 31-46.
Béatrice Bonhomme, « Ville et Archéologie chez Michel Butor et Henri Maccheroni », paru dans Loxias-Colloques, 1. Voyage en écriture avec Michel Butor, Le pas du texte, Ville et Archéologie chez Michel Butor et Henri Maccheroni, mis en ligne le 15 décembre 2011, URL.↩
2. 2003. Désormais, je noterai juste entre parenthèses (Tessa Tristan, suivi de la page). Tessa Tristan, Dioptrique(s) dans l’œuvre d’Henri Maccheroni, Paris, Daniel Duchoze, Ipsa Facta, décembre↩
3. Michel Butor, « La visée archéologique pour Henri Maccheroni », Lucinges, décembre 2010 dans Catalogue de la ville de Saint-Raphaël, De l’archéologie et de la ville chez Henri Maccheroni, rétrospectives thématiques, expositions d’avril à octobre 2011, p. 7.↩
4. Jean Petitot, « Le sens du temps », Catalogue de la ville de Saint-Raphaël, op. cit., p. 12.↩
5. Michel Butor, Catalogue de la ville de Saint-Raphaël, op. cit., p. 7.↩
6. Ibid.↩
7. D’après Marie-Claire Kerbrat, Leçon littéraire sur l’Emploi du temps de Michel Butor, Paris, PUF, 1995, p. 67.↩
8. D’après Georges Godin, Michel Butor : Pédagogie, littérature, Brèches, 1987, p. 141.↩
9. Raphaël Monticelli, « Premières tentatives sur la notion d’archéologie virtuelle » (texte inédit de 1987) dans Tessa Tristan, op. cit., p. 23.↩
10. Michel Butor dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, Problèmes de l’art contemporain à partir des travaux d’Henri Maccheroni, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1983, p. 30.↩
11. Henri Maccheroni, Descriptif des séries pour le catalogue Œuvres croisées I, Opere incrociate, 1975-1985, Florence, Casa Usher, 1986, p. 45-46.↩
12. Michel Butor, dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 36.↩
13. Termes relevés dans Almageste (pour l’Archéologie blanche, 1976) et La Vallée des Dépossédés (pour les New York, First-Time (1980-1982).
14. Michel Sicard dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 42.↩
15. Michel Butor dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 49.↩
16. Michel Butor dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 123.↩
17. Ibid., p. 124.↩
18. Ibid.↩
19. Ibid., p. 139.↩
20. Termes relevés dans Rêve d’Archéologies blanches (pour L’Étagère aux bocaux (1972) et les Archéologies blanches et Almageste.)↩
21. Michel Sicard dans l’Entretien Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 108.↩
22. D’après Michel Butor dans l’Entretien Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 121.↩
23. Michel Serres, dialogue avec Michel Butor : « Jules Verne, la découverte et le séjour ».↩
24. Cf. Béatrice Bonhomme, in Analyses et réflexions sur Michel Butor L’Emploi du temps, « La véritable recherche », p. 119-122, op.cit.↩
25. Anne Joncheray et Bertrand Roussel, « De l’archéologie et de la ville chez Heni Maccheroni », Catalogue de Saint-Raphaël, op.cit.↩
26. Henri Maccheroni, dans Emblèmes de la ville : la ville univers de toutes les pluies, Coaraze, L’Amourier, « Carnet » n° 3, 1999, p. 48.↩
27. D’après Henri Maccheroni, Emblèmes de la ville, op. cit.↩
28. Michel Butor, « la ville comme accumulation de texte », « la ville comme texte » dans Répertoire V, p. 36.↩
29. William, Schuman, Dans la nuit, Revue L’animal, Littératures, arts et Philosophies n° 11/12, 2000-2001,p. 41.↩
30. Michel Sicard dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 63.↩
31. Michel Butor, Catalogue de Saint-Raphaël, op.cit.a href= »#section31″ aria-label= »Back to content »>↩
32. Michel Butor, « La ville comme texte » II, « La ville comme accumulation du texte », Répertoire V, Minuit, 1982.↩
33. Henri Maccheroni, descriptif des séries pour le catalogue Œuvres croisées I, Oper incrociate, 1975-1985, Casa Usher, Florence, 1986, p. 45-46.↩
34. Michel Sicard dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 63-64.↩
35. Entretien entre Michel Butor et Frédéric Appy sur le livre-objet, Nice, 13 novembre 1978.↩
36. Termes relevés dans Rêve d’Archéologies blanches, Œuvres croisées, Prolongement : De la ville et de quelques autres lieux, Revue Nu(e), Bibliothèque de l’Université de Nice, section Lettres, Exposition 12 octobre-15 novembre 1998.↩
37. Michel Butor dans l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op .cit., p. 153.↩
38. Ibid.↩
39. Tout ce passage sur les rapports de l’œuvre de Butor et celle de Maccheroni est écrit d’après l’Entretien entre Michel Butor et Michel Sicard, op. cit., p. 92-93, 95, 105, 107-111, 117-125, 127, 135, 137, 153.↩
40. Lucien Dällenbach, Le livre et ses miroirs dans l’œuvre romanesque de Michel Butor, Archives des Lettres modernes n°135, Paris, Editions Minard, 1972, p. 86.↩
41. D’après Lucien Dällenbach, Archives n° 135, p. 89↩
42. Ibid.↩
